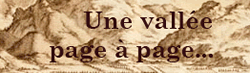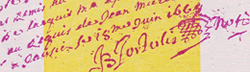Sabença de la Valeia - Amis du musée de la vallée
François de Meyronnes (1288-1328)
Le texte proposé (non reproduit dans son intégralité) présente la biographie de François de Meyronnes publiée dans « l’histoire de la littérature de la France » (1863-1900) tome 36, de la page 305 à la page 312.
Les passages sélectionnés nous permettent d’approcher cette autorité intellectuelle, très mal connue, du XIVe siècle. C’est grâce à ses qualités et la stature acquise dans le milieu universitaire parisien que ce célèbre docteur en théologie d’origine ubayenne entra au service de la papauté. Une plaque apposée sur un mur de l’église de Meyronnes rappelle son souvenir.
Le 24 mai 1323, Jean XXII écrit au chancelier de l’Église de Paris que François de Meyronnes de Digne frère mineur, bachelier en théologie, qui a achevé le cours normal de « lectures » imposé par l’usage aux bacheliers en théologie, est digne de recevoir la licence ; et à la requête de Robert, roi de Sicile, il le prie de la lui conférer.
Le pays d’origine de frère François est ainsi bien déterminé : il n’était ni écossais ou irlandais, comme ont passé pour l’être plusieurs des disciples de Duns Scot (et lui entre autres), ni catalan comme on l’a dit en le confondant probablement avec le clerc séculier « Franciscus Mironis », qui obtint en janvier 1307 l’expectative d’un canonicat dans l’église d’Elne.
On ne sait pas directement à quelle époque il était né ; et le fait qu’il ne fût encore en 1323 que bachelier en théologie est à peine un indice à cet égard. De sa famille on ne sait rien. Les biographes se transmettent une tradition d’après laquelle il aurait été « de la famille des hospitalieri » mais la source primitive de cette affirmation, que l’on trouve, pour la première fois sous la plume de Rémerville de Saint Quentin, historien d’Apt et de Saint Elzéar de Sabran au XVIIIe siècle, est inconnue. Il en est de même de celle de Nicolas Chorier (histoire du Dauphiné, T II Lyon 1672, p 238) : « François de Mayronis était natif du Lizet, paroisse du diocèse (d’Embrun) ».
Il n’est pas douteux, du moins, qu’il ait d’abord fait profession dans un couvent de son ordre en Provence. Un étudiant de Montpellier, qui, en 1423-1424, a transcrit sur ses cahiers plusieurs questions de François de Meyronnes, écrit à la fin de l’une d’elle : « explicit questio per seraphicum doctorem magistrum Franciscum de Mayronis, O.M.,provincie Provincie et conventus Digne ». L’explicit de son recueil de quolibets le dit aussi « Ordinis Minorum, provincie Sancti Ludovici ». Il aurait même été quelques temps « gardien » du couvent de Sisteron s’il faut en croire (et pourquoi pas ?) une note placée en tête de son traité sur l’Immaculée Conception par l’étudiant de Montpellier précité : « Francisco de Mayronis, Ordinis Minirum, provincie Provincie, custade Sistariensi ». Il y a un éloge de la Provence dans un sermon de François de Meyronnes sur Saint Louis, évêque de Toulouse (cité dans le Breviairium historico-chronologico-criticum…. du P.Fr Pagi, T IV, Antverpiae, 1727, p 58).
A quelle époque fut-il envoyé au Studium de Paris pour étudier et enseigner ? Y-a-t-il connu personnellement Duns Scot, qui fut transféré de Paris à Cologne en 1308 ? On l’ignore. Notons seulement qu’une reportotio à une de ses lectures à Paris sur le premier livre des Sentences est datée de 1380. Plusieurs traditions ont trait à frère François pendant son séjour à l’université de Paris, qui fut certainement d’assez longue durée. Sbaralea dit qu’il fut le socius et l’émule, aux écoles de Paris, du dominicain Hervé Le Breton (Nédelec)……
Il est certain d’ailleurs que Pierre Roger, le futur Clément VI, lorsqu’il n’était encore que prieur de Saint Pantaléon (Corrèze), fut, en vérité, lui aussi, un émule de frère François. Le manuscrit 39 du fonds Borghese à la bibliothèque du Vatican contient, en effet, les pièces d’une controverse universitaire entre ces deux personnages, dont l’une est datée du 14 avril 1321. Il en sera question plus loin.
En 1323, un seigneur provençal, Elzéar de Sabran, comte d’Ariano dans le royaume de Naples, fut envoyé à la cour de France pour négocier le mariage du fils unique de son maître, le roi Robert de Naples, avec une fille de France. Il tomba malade à Paris, et sentant la mort approcher, il demanda l’assistance spirituelle de son compatriote, frère François de Meyronnes, qui résidait alors au couvent de son ordre dans la capitale. Est-ce sur les conseils de ce confesseur qu’il crut devoir édifier l’assistance, à son lit de mort, en déclarant que, quoiqu’il fût marié depuis vingt-cinq ans, il n’avait jamais, d’accord avec elle, touché son épouse Delphine….
Delphine était alors à la cour de Robert de Naples, en Avignon, attachée à la personne de la reine Sanche, la clarisse. L’abstinence conjugale du comte Elzéar, d’autant plus méritoire que Delphine (dont on n’a pas d’ailleurs le portrait) était plus agréable, et surtout sa singulière indiscrétion finale à ce sujet, ont beaucoup contribué à sa canonisation, qui fut prononcée en 1369….
Prouesse étonnante en tout cas, de la part d’un envoyé choisi entre tous pour aider l’héritier du trône à prendre femme. Le comte Elzéar fut enterré, sous l’habit franciscain, au couvent des Mineurs de Paris, celui de François de Meyronnes, avant d’être transporté à Apt.
Enfin une tradition indéracinable puisqu’elle se trouve encore dans le Handbuch der Geschichte des Franzis Kaner Ordens d’Hériben Holzapfelek dans le manuel scotiste du P.A Bertoni, quoiqu’on en ait depuis longtemps signalé le caractère fabuleux, veut que François de Meyronnes ait introduit en 1315, d’autres disent en 1320, dans l’Université de Paris (on n’indique pas comment ni en quelle qualité) l’actus sorbonicus, c’est-à-dire les controverses du vendredi où, dans la saison d’été, le même argumentateur avait à répondre, du matin au soir, douze heures durant, à tous les antagonistes qui se présentaient.
Il semble que frère François ait été rappelé dans sa province peu de temps après la mort du comte Elzéar et après son accession à la maîtrise. En effet, il devait être en cour d’Avignon lorsque, la « huitième année » de son pontificat (1324), Jean XXII l’envoya en Gascogne, de conserve avec le dominicain Dominique Grima, pour négocier la paix entre les rois Charles de France et Edouard d’Angleterre.
François de Meyronnes est, à cette occasion qualifié, comme son collègue, alors lecteur du Sacré Palais, de « professeur en théologie ».
On verra plus loin que, d’après une note ancienne d’un manuscrit d’Assise frère François aurait été ministre de sa province franciscaine de Provence à l’époque où la controverse sur la question de la Pauvreté du Christ et des Apôtres battait, comme on dit, son plein à la curie, c’est-à-dire après le constitution Quiaquorumdam du 10 novembre 1324.
Quoiqu’il en soit, d’autres notes du même genre, jointes à des sermons de lui, indiquent qu’il eut l’honneur de prêcher vers ce temps-là à la cour d’Avignon, devant Jean XXII et les cardinaux.
François de Meyronnes est mort à Plaisance en Italie, d’après l’explicit de l’édition de ses Passus super universalia et predicamenta publiée à Bologne en 1488….
La martyrologue franciscain atteste d’ailleurs que sa mort eut lieu le 26 juillet. En quelle année ? Sbaralea a souligné le fait que « Thomas Anglicus », sans doute Thomas Walleis, « qui vivait encore en 1333 », est cité dans le commentaire de frère François sur les Sentences, mais ce fait n’apprend rien d’utile. Les millésimes 1325 et 1327, et la date « vers 1330 », ont été proposés par les anciens bibliographes. Il semble que le millésime 1325 soit le plus anciennement attesté et que celui de 1327 n’ait été mis en avant que parce qu’un écrit, soi-disant de cette année, a été attribué, peut-être au hasard, à notre auteur.
On peut dire, en tout cas, qu’il est mort sans doute assez jeune, puisqu’il ne fut point revêtu des hautes dignités ecclésiastiques qu’il était certainement en passe d’obtenir, vers 1324, grâce à la bienveillance du roi de Naples et du souverain pontife.
Le roi Robert avait provoqué ses travaux sur Denis l’Aéropagite. Le pape lui avait mis le pied à l’étrier. Il est mort trop tôt pour les récompenses terrestres. Pietro-Maria Campi, dans son « Histoire de Plaisance », a inséré l’épitaphe qui se lisait de son temps, et depuis 1477, sur le tombeau de François de Meyronnes en l’église des franciscains de Plaisance. Ce qui n’empêche pas d’ailleurs que l’on ait longtemps montré le tombeau du grand homme « contre la muraille derrière la petite porte de l’église Sainte Croix », à Apt (cf. Barjavel).
Doctor acutus, Doctor illuminatus, telles sont les épithètes qui, dans la seconde moitié du XIVe siècle et au XVe, servaient à qualifier François de Meyronnes, souvent aussi désigné par son prénom, sans plus : « Magister Franciscus », voire « Franciscus » tout court. Magister abstractionum, ce surnom qu’on lui donne encore aujourd’hui n’est pas attesté à une époque aussi ancienne. Mais il est déjà considéré comme normal dans la notice datée de 1504, qui précède la première édition de ses principaux ouvrages, procurée en Italie par le franciscain irlandais Maurice O’Fihely (Mauricius Hibernicus)….
Après avoir brillé d’un vil éclat au XIVe, au XVe et au XVIe siècle, surtout hors de France, en Italie et en Angleterre, comme l’attestent les manuscrits et les éditions qui seront indiqués plus loin, et pareillement en Espagne, la réputation de François de Meyronnnes, s’affaissa……
De nos jours, il est bien connu qu’il fut un des principaux, sinon le principal des disciples immédiats de Duns Scot, qu’il appelle constamment Doctor Noster qu’il allègue sans cesse et dont il ne se sépare presque jamais….
Autres sources documentaires
Barbu (Marie), La formation universitaire et l'univers culturel de François de Meyronnes, École française de Rome, Rome, 1972 (revue).
Liens externes
François de Meyronnes dans l' Encyclopédie franciscaine Wikitau